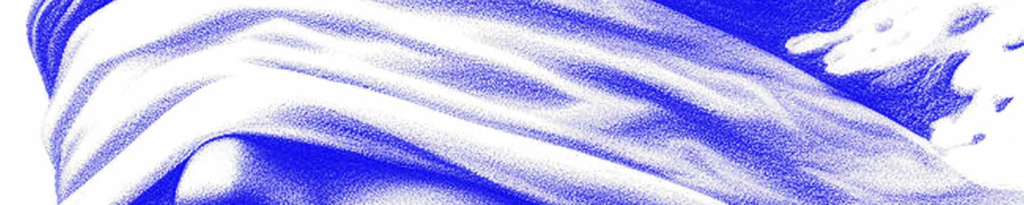
Thibault MERCIER, Avocat à la cour
Aux origines du concept de souveraineté
« Rex est imperator in regno suo1 », c’est par cet adage qu’au XIIIe siècle les juristes de Philippe Auguste lui ont permis d’affirmer son indépendance vis-à-vis du Saint-Empire romain Germanique en posant le principe que sur le territoire du royaume de France, le roi n’a aucun suzerain. Ainsi a commencé la lente construction du concept de « souveraineté » pour justifier la prétention de certains royaumes et cités à décider, juger et légiférer par eux-mêmes2 dans une Europe morcelée par plusieurs siècles de féodalité.
Sans encore en saisir nettement les contours, on devine déjà que pour une entité politique, affirmer sa souveraineté lui permet de garantir son indépendance et de régler ses propres affaires sur son territoire, sans en devoir aucun compte.
Souveraineté et liberté : deux concepts inextricablement liés
Et sans cette souveraineté, cette entité pourra-t-elle réellement exercer sa liberté ? Une brève consultation du mot « liberté » dans le dictionnaire suffit pour remarquer que ces deux concepts sont inextricablement liés. La liberté, selon nos académiciens, est ainsi pour l’individu le « droit d’agir et de se déterminer souverainement » et pour un Etat celui de « détermine[r] souverainement son mode de gouvernement3 ». Inutile d’être un grand spécialiste des idées politiques pour comprendre que la souveraineté est une des conditions sine qua non de la liberté.
Au XIVe siècle, les Républiques du Nord de l’Italie dans leurs luttes contre le Saint-Empire romain germanique l’avaient déjà compris quand elles ont revendiqué leurs « libertés », c’est-à-dire affirmé leur droit, tout à la fois, d’avoir un gouvernement républicain et d’être « souveraines » par rapport à toute puissance extérieure4.
De la souveraineté royale à la souveraineté nationale
La notion de souveraineté rencontrera ensuite le succès qu’on lui connaît et deux siècles plus tard, Jean Bodin, grand théoricien de l’absolutisme royal, en définira précisément ses attributs : donner et casser les lois, décider de la guerre et de la paix, nommer tous les agents de l’Etat, juger en dernier ressort et exercer le droit de grâce. Le roi aura donc acquis son autonomie (soit littéralement la faculté de « se donner ses propres lois ») mais devra bientôt transférer cette souveraineté, ardemment conquise, à son peuple. A la fin du XVIIe siècle, sous l’impulsion de la Réforme et des Lumières, c’est en effet le concept de souveraineté nationale qui se développe et qui se verra notamment consacrée en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et son article 3 énonçant que « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corp, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » La loi est alors devenue l’expression de la volonté générale.
Au-delà du « mythe de la souveraineté nationale », l’institution du « culte » de la souveraineté individuelle
Mais ce n’est pas sur la souveraineté étatique que nous nous attarderons ici – ce sujet ayant certainement déjà été abondamment discuté dans cette édition de la revue – et nous glisserons plutôt du côté de la souveraineté individuelle. Car la Modernité philosophique a non seulement créé le « mythe de la souveraineté nationale » (selon l’expression du professeur de droit Léon Duguit), mais aussi permis d’instituer « le culte de la liberté individuelle » en mettant ainsi « face à face la souveraineté de l’État et la souveraineté de l’individu5 ». La souveraineté étant théoriquement indivisible, comment ces deux souverainetés vont-elles se concilier ? L’une devra-t-elle céder à l’autre ? Toujours selon Duguit, si la souveraineté nationale est la puissance de faire des lois, d’assurer l’exécution de ces lois, de juger les différends qui naissent de cette exécution ; cette puissance a toutefois une limite, dont le fondement et la mesure se trouvent dans les droits naturels de l’homme, auxquels elle ne peut porter atteinte. La souveraineté de l’État peut ainsi limiter les droits individuels, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les droits de tous, et elle ne peut le faire que par la loi, votée démocratiquement.
Des droits-libertés aux droits-créances
Depuis près de trois siècles désormais l’individu aura lui aussi acquis sa liberté face à un État qu’on soupçonnera toujours de tendre vers le despotisme. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 viendra parfaire ce dispositif de protection de la personne humaine contre le fantôme d’Hitler et les dictatures de tous bords. Concomitamment à l’affirmation de ces « droits-libertés » nous assisterons également au développement croissant du concept de « droit-créance », dont le préambule de la Constitution de 1946 nous offre de nombreux exemples (droit au travail, droit à la santé ou encore droit à l’instruction). Détenir un tel droit-créance permet ainsi d’obtenir un avantage délié de toute charge ou obligation, une véritable créance sur la collectivité qui sera tenue de rendre effectif le « droit à » de l’individu.
Une opposition de principe entre le collectif et l’individu
S’il est généralement considéré que la multiplication des droits individuels et la construction de ces droits-créances ont été un progrès social pour l’individu, certaines voix en ont néanmoins pointé les dommages collatéraux. Pour le doyen Carbonnier6, la prolifération des droits subjectifs a conduit à l’affirmation désordonnée d’une infinité de passions individuelles en rivalité entre elles alors que chacun de ces droits arrive armé d’une action en justice. Nous pouvons également noté, avec le philosophe Alain de Benoist, que l’individu développe désormais une « exigence de légitimation et de reconnaissance publique — y compris par la loi — de n’importe quelle forme de désir, dès lors assimilé à un besoin » et que « la tendance actuelle (…) consiste à convertir en “droit” toute espèce d’exigence, de désir ou d’intérêt7. » Enfin, pour le philosophe Pierre Manent, ces droits, arrivés au terme de leur extension, s’opposent victorieusement à toute règle collective rendant ainsi la loi (générale) esclave des droits individuels8.
Ce mouvement d’atomisation de la société en d’innombrables individus qui n’hésitent pas à remettre en cause le collectif a créé, pour les États modernes, des difficultés politiques constantes dans leur gouvernement. Le professeur Anne-Marie Le Pourhiet a justement noté que l’État a désormais pour seul fonction d’être un « self-service normatif » ou un « lex-shop » à la disposition de tous les intérêts catégoriels9. On voit alors apparaître une des causes possibles du délitement du lien social en France et plus généralement en Occident : l’avènement d’une génération composée d’individus qui considèrent que leurs droits individuels prévalent sur l’intérêt général. Fort de ces nouveaux droits, chacun cherche à maximiser son intérêt personnel, chacun peut faire plier la nation sous le poids de son désir et nous en sommes arrivés à une opposition de principe entre l’individu et le collectif.
Quelle conception de la liberté ?
Alors qu’une certaine métaphysique de l’illimité nous pousse à réclamer toujours plus de droits et de libertés, il apparaît nécessaire de nous souvenir que notre liberté individuelle peut non seulement être limitée par la loi mais aussi par les limites inhérentes à notre condition d’être humain. Simone Weil écrivait à cet effet que, pour un homme responsable, les limites ne doivent pas être vues comme des restrictions à nos libertés. Seul un enfant verrait par exemple l’impossibilité de manger un champignon vénéneux comme une limite10. Le philosophe allemand Leo Strauss reconnaissait en cette limite l’exigence d’une norme idéale, et transcendante, qui permet de juger ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, pour que l’homme agisse raisonnablement et ne tombe pas dans la démesure. Selon lui, « la liberté consiste à faire de la manière convenable seulement ce qui est bien ; et notre connaissance du bien doit venir d’un principe supérieur, elle doit venir d’en haut.11».
Des droits aux devoirs ?
Nous terminerons cette digression en rappelant les mots qu’Alexandre Soljenitsyne prononça en 1978 lors de son célèbre discours de Harvard : « Il est temps, à l’Ouest, de défendre non pas tant les droits de l’homme que ses devoirs12 ». Si la souveraineté individuelle a permis l’émergence d’une conception négative de la liberté, c’est-à-dire la possibilité pour l’individu de faire sécession de la société (mais aussi de la faire plier sous son désir égoïste), il est possible de nous souvenir qu’il existe aussi une conception positive de cette liberté, qui implique une participation de l’individu dans la vie de la Cité. Partant, une liberté ne peut aller sans devoir ni responsabilité envers sa communauté.
- Le roi est empereur en son royaume
- voir Philippe Nemo, Histoire des idées politiques dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Presses Universitaires de France, 2014
- Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition
- Histoire des idées politiques dans l’Antiquité et au Moyen Âge, op. cit
- Léon Duguit, Souveraineté et Liberté, Librairie Félix Alcan, 1922
- Jean Carbonnier, Droit et Passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1994
- Alain de Benoist, Au-delà des droits de l’homme, Pierre-Guillaume de Roux, 2016
- Pierre Manent, La Loi naturelle et les Droits de l’homme, Presses universitaires de France, 2018
- Anne-Marie Le Pourhiet, « Pour une analyse critique de la discrimination positive », Le Débat, n° 114, Gallimard, 2001
- Simone Weil, L’Enracinement, Gallimard, 1949
- Leo Strauss, Qu’est-ce que la philosophie politique ?, Presses universitaires de France, 2016 (édition originale, 1959)
- Alexandre Soljenitsyne, Le Déclin du courage, Les Belles Lettres, 2014
