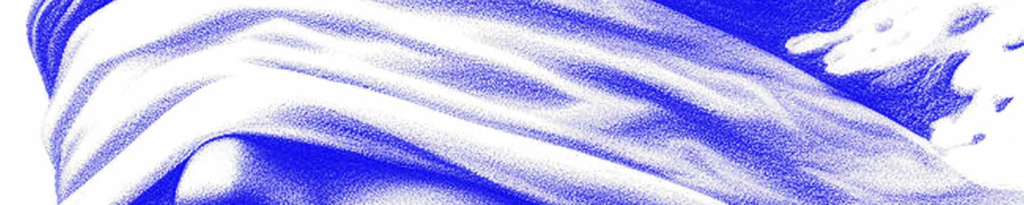
Jean-Eric SCHOETTL,Conseiller d’Etat honoraire, Ancien secrétaire général du Conseil Constitutionnel
Aux termes de l’article 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Cette disposition, sans être complètement vidée de son sens, a vu sa portée substantiellement amoindrie depuis un demi-siècle sous l’effet de deux puissants facteurs.
En premier lieu, dans l’ordre international, la souveraineté nationale se rétracte. Cette rétraction résulte tant des transferts de compétences au profit de l’Union européenne (y compris dans des domaines régaliens) que de la conclusion, dans tous les domaines, notamment ceux du « droit des gens », de l’environnement, de la responsabilité éthique des entreprises et des échanges commerciaux, de traités qui produisent des effets juridiques non seulement entre Etats, mais également entre Etats et particuliers, voire entre personnes, et qui souvent nous lient à l’égard d’organes internationaux (y compris juridictionnels), chargés de veiller à la complète application du traité.
En second lieu, dans l’ordre interne, la souveraineté populaire est amoindrie par un droit toujours plus prégnant, qui déborde et contraint la loi, et dont la source se trouve ailleurs que dans la loi : plus particulièrement dans la jurisprudence des cours suprêmes, nationales et supranationales.
Souveraineté de l’Etat et souveraineté dans l’Etat : les deux ont été soumises depuis cinquante ans à une intense attrition. Le modèle westphalien de la souveraineté nationale, comme le modèle démocratique de la souveraineté du peuple s’exerçant au travers de ses élus, ont été pareillement malmenés.
Comment nier que la place de la loi dans la hiérarchie des normes se soit affaiblie depuis quarante ans ? Il fut un temps, pas si lointain (je l’ai connu en qualité d’auditeur lorsque je suis entré au Conseil d’Etat en 1979), où la loi trônait au sommet de l’édifice juridique. La loi fixait les règles ou les principes fondamentaux, selon la typologie fixée à l’article 34 de la Constitution de 1958 ; le décret en déterminait les modalités d’application ; le juge interprétait la loi dans le strict respect de l’intention du législateur, telle qu’elle se dégageait des travaux parlementaires ; la loi postérieure au traité faisait écran à ce dernier, du moins aux yeux du juge administratif.
Tout cet édifice s’est retrouvé chamboulé au cours d’une évolution couvrant une cinquantaine d’années. Cette évolution (qui n’est pas propre à la France) conjugue divers phénomènes : la primauté du droit international et européen ; l’expansion des droits fondamentaux, qui déborde, notamment du côté sociétal, ce que l’on nommait pompeusement dans les années 80 « la troisième génération des Droits de l’homme » ; la montée en puissance du pouvoir juridictionnel ; des révisions constitutionnelles restreignant toujours davantage le pouvoir du Représentant élu de la Nation comme celui du Gouvernement.
La Constitution est-elle toujours située au sommet de la hiérarchie des normes ? Dans l’ordre juridique interne assurément. Mais non dans l’ordre juridique européen et international. Or celui-ci est de plus en plus envahissant. Une cour constitutionnelle qui entraverait le fonctionnement des institutions européennes exposerait son pays à une procédure en manquement.
La Constitution a consenti à son autolimitation dans son titre XV qui élève au rang constitutionnel les traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne signés à Lisbonne le 13 décembre 2007. Elle entérine les atteintes portées par la construction européenne à ce que le Conseil constitutionnel a appelé « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».
Sauf révolte provoquant une crise systémique, le « dialogue » entre juges nationaux et européens est une façon euphémistique de présenter une relation de vassal à suzerain. Même là où existent des « marges de manœuvre », les juges nationaux pratiquent le suivisme, voire la surenchère, à l’égard des cours supranationales.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le droit au regroupement familial des étrangers séjournant en France, emboîtant le pas à la CEDH qui, pour sa part, avait déduit ce droit de l’article 8 de la convention européenne des droits de
l’homme (droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale »).
C’est ainsi encore que, dans l’affaire de la conservation et de l’utilisation des données des communications électroniques à des fins pénales ou de renseignement, le Conseil d’Etat s’est interdit par avance d’opposer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en matière de sécurité, un veto analogue à celui émis par la Cour de Karlsruhe en matière monétaire. C’est même à une capitulation sans condition que procède son arrêt French Data Network du 21 avril 2021 : « Contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres ».
De même, s’agissant de la directive « temps de travail », le Conseil d’Etat a jugé le 17 décembre 2021 que le principe constitutionnel de « nécessaire libre disposition de la force armée » ne faisait pas globalement obstacle à l’application de cette directive aux militaires français (Assemblée du contentieux, 17 décembre 2021).
Dans l’ordre juridique interne, la souveraineté, prise cette fois dans sa dimension populaire (la loi votée par le Parlement), plie l’échine devant le pouvoir juridictionnel.
L’extension du contrôle juridictionnel est en grande partie l’œuvre du constituant (ouverture de la saisine constitutionnelle aux parlementaires en 1974, institution de la « question prioritaire de constitutionnalité » en 2008, autorisation de ratifier des traités européens instituant la primauté du droit de l’Union et le contrôle de la CJUE …), ainsi que du législateur (référé libertés administratif, injonctions assortissant les annulations pour excès de pouvoir). Dans cette mesure, elle a été largement consentie par le politique.
Mais elle est aussi le fait du juge lui-même. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a décidé en 1971 qu’il contrôlerait la conformité de la loi à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946 et aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ainsi encore, le Conseil constitutionnel a pris sur lui d’enjoindre au juge du fond, en 1975 (IVG), d’écarter la loi contraire au traité, même lorsqu’elle lui était postérieure. Ainsi toujours, en 2020, il s’octroie le pouvoir de contrôler, au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, les ordonnances non ratifiées (lesquelles contribuent aujourd’hui, pour une part substantielle, à la production normative).
Cette extension du pouvoir du juge, sur le plan des compétences et des méthodes, trouve son prolongement dans sa jurisprudence. Dans bien des domaines (droit des étrangers par exemple), la jurisprudence des cours suprêmes, nationales et européennes, formate les politiques publiques. La subordination de la loi aux traités, aux actes de droit européen dérivé et aux décisions des cours nationales et supranationales conduit à l’impasse démocratique définie par Henri Guaino dans le Figaro du 27 octobre 2021 : vouloir faire la démocratie par le droit plutôt que le droit par la démocratie.
Un droit qui trouve de moins en moins son siège dans la loi et de plus en plus dans le traité et la jurisprudence. Un droit qui s’émancipe de la loi et contraint la loi. Et donc un juge qui, au travers des plaintes pénales, des recours constitutionnels et des saisines des cours européennes et organes para-juridictionnels supranationaux, établit son emprise sur le politique.
Il faut par ailleurs s’interroger sur le biais que cette évolution imprime au contenu même du droit. De façon générale, on peut en effet se demander si le rôle des juridictions ne tend pas aujourd’hui globalement à faire primer les droits subjectifs et les intérêts particuliers sur l’intérêt général et la souveraineté nationale.
Un précédent Premier président de la Cour de cassation définissait le juge judiciaire comme le gardien des libertés (par opposition, je suppose, à une juridiction administrative taxée de connivence avec le pouvoir et donc congénitalement indifférente aux libertés). Il estimait notamment que le juge pénal n’avait pas à intérioriser l’exigence collective de sécurité, cette fonction, en quelque sorte subalterne, étant dévolue aux forces de l’ordre.
L’emprise croissante du juge sur la démocratie revêt deux aspects distincts, quoique non étrangers l’un à l’autre : le droit se construit désormais de plus en plus en dehors de la loi, voire contre elle ; la pénalisation de la vie publique prend des proportions paralysantes. Ces deux aspects sont liés car ils conduisent tous deux à la dégradation de la figure du Représentant : le premier en restreignant toujours plus étroitement sa latitude décisionnelle ; le second en faisant du Représentant un perpétuel suspect. On objectera que l’affermissement de la fonction juridictionnelle, s’exerçant sur toutes les catégories d’actes des pouvoirs publics et sur les personnes de nos dirigeants, conduit à davantage de rigueur et de transparence dans le fonctionnement démocratique ; qu’elle nous met à l’abri d’aventures antidémocratiques…
C’est vrai en bonne partie. Mais, pour une part non négligeable, cette évolution a remplacé le caprice du prince par le caprice du juge.
- Est-ce au juge, plutôt qu’aux représentants élus de la Nation, de décider si l’insémination post mortem, c’est-à-dire par emploi des gamètes du mari défunt, doit être ou non possible ?
- Ou si le changement de genre doit être enregistré par l’Etat-civil à la seule demande de l’intéressé et sans production d’un certificat médical ?
- Ou si le regroupement familial des étrangers est de droit ?
- Ou si l’accès à l’université ne peut faire l’objet que de droits d’inscription modiques ?
- Ou si la faculté de garder le silence doit être notifiée à la personne gardée à vue ?
- Ou si les drones utilisés par la police lors de manifestations doivent ou non permettre d’identifier les fauteurs de trouble ?
- Ou si la CSG peut ou non être progressive ?
Sur tous ces sujets, la norme a été fixée non par un Parlement, mais par une cour suprême, nationale (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de cassation) ou supranationale (CEDH, CJUE).
Les dispositions dans lesquelles le juge va chercher l’énoncé d’un droit font l’objet de formulations le plus souvent vagues, dont le juge est l’ultime exégète. Sa jurisprudence déterminera donc à la fois les implications véritables et la force contraignante de l’énoncé constitutionnel ou conventionnel en cause. Les intentions du constituant ou celles des négociateurs du traité ne feront plus entendre, à ce stade, qu’un écho lointain.
La religion des droits fondamentaux et, plus généralement, ce que Marcel Gauchet a appelé l’« abouchement du droit des juristes et du droit des philosophes » ont fait émerger un juge démiurge, à l’image de la Cour suprême des USA, du Verfassungsgericht, des cours de Strasbourg et de Luxembourg et de leurs divers émules en Occident.
Ce juge démiurge, non content d’imposer la prépondérance des droits individuels sur l’intérêt général, en énonce de nouveaux, en produisant à jet continu, par-dessus la tête du Représentant, un droit supra-législatif ineffable et arborescent, élaboré sans garde fou à partir des formulations très générales qui abondent dans nos textes constitutionnels et conventionnels. C’est ainsi que, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel confère pour la première fois une portée normative au troisième élément de la devise républicaine (la fraternité).
Cette apothéose du juge est saluée par la nouvelle doxa juridique, avec des accents eschatologiques, comme l’accomplissement de l’Etat de droit. Du coup, le prétoire, plus encore que l’hémicycle, devient un enjeu pour les ONG, les groupes de pression et de leurs juristes (promus experts par les médias et par Bruxelles). Cercle vicieux car cet engouement pour le juge renforce l’hubris juridictionnelle et marginalise toujours plus les élus et gouvernants, réduits au rôle d’exécutants des arrêts ou à la fonction de souffre-douleur d’ailleurs consentant (masochisme attesté par la récurrence des lois de moralisation de la vie publique et par la résignation de la classe politique à la judiciarisation des affaires publiques). Et cette marginalisation, confinant à l’impuissance, nourrit la défiance de l’opinion à l’égard des élus et de l’Exécutif. Le général de Gaulle aurait-il pu imaginer que la Vème République allait prendre ce visage ?
Le juge était la bouche de la loi pour Montesquieu ; c’est désormais la loi qui est la bouche du juge, car elle se borne de plus en plus souvent à codifier sa jurisprudence. Les gens ordinaires pensent encore naïvement que l’Etat de droit c’est un Etat qui, certes, ne peut pas faire n’importe quoi, mais qui dispose de coudées franches pour assurer leur protection, et notamment pour veiller à leur sécurité et sauvegarder les intérêts supérieurs de la Nation. Une grande partie de la doctrine vit sur une autre planète. Ne s’est-elle pas longtemps et farouchement opposée au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et à la vidéosurveillance, devenus pourtant indispensables à notre sécurité ? Pour la doxa, ce qui menace l’Etat de droit c’est l’état d’urgence plus que le terrorisme.
