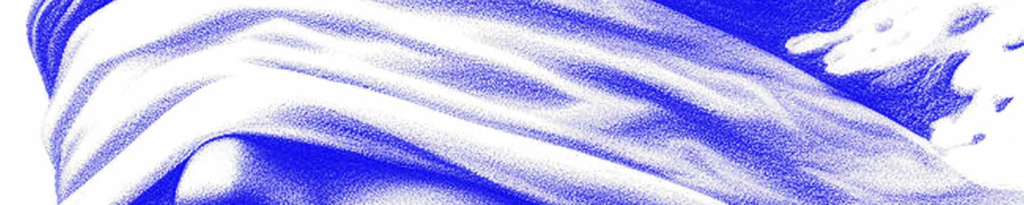
Olivier DE MAISON ROUGE, Avocat, Docteur en droit
Dernier ouvrage paru : « Gagner la guerre économique. Plaidoyer pour une souveraineté économique et une indépendance stratégique » VA Editions, 2022
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 16-24 août 1789.
Tel a été forgé le principe de souveraineté dès les prémices de la Révolution française. Il s’agit en effet de la traduction de la pensée de l’abbé Sieyès ainsi traduite dans les nouvelles Tables de la loi de 1789. À suivre ce précepte, la Souveraineté s’exerce dans le cadre exclusif de la nation. Ce faisant, la souveraineté est d’essence patriotique, sans partage ni délégation.
Qu’est-ce que la souveraineté ?
En vérité, la question de souveraineté, au-delà du renvoi sémantique à l’autorité du roi et aux regalia, est davantage une notion relevant des sciences politiques et en particulier pose les conditions d’exercice de l’exercice de la volonté politique et son organisation institutionnelle.
La souveraineté est en effet d’abord un instrument politique, comme affirmation de la primauté des institutions sur les autres sphères : qu’elles soient économique, industrielle, numérique, financière, etc. Autrement dit : Être souverain, c’est être maître chez soi.
Depuis le 16e siècle et les écrits de Jean Bodin, la souveraineté est devenue une notion juridique qui marque l’avènement de l’État moderne, qu’il définit comme suit :
« La souveraineté est le pouvoir de commander et de contraindre, sans être ni commandé ni contraint ».1
Sa définition est reprise trois siècles plus tard par le juriste français Louis le Fur qui voit dans la souveraineté la qualité d’un État :
« de n’être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu’il est appelé à réaliser »2.
Souveraineté et Révolution française
Au siècle des Lumières, le principe de souveraineté est une idée répandue, discutée par les philosophes, avant sa consécration politique dans les commandements de 1789. Jean-Jacques Rousseau, apôtre de la cohésion nationale, sous la forme du Contrat social, voit l’expression de la souveraineté à travers l’exercice du pouvoir par le roi :
« La volonté du souverain est le souverain lui même. Le souverain veut l’intérêt général, et, par
définition, ne peut vouloir que l’intérêt général »3.
Selon l’auteur de Julie ou la Nouvelle Héloïse, la souveraineté présente quatre caractères :
- Elle est inaliénable. La souveraineté ne se délègue pas. Rousseau condamne le gouvernement représentatif et la monarchie à l’anglaise : « Les députés du peuple ne sont ni ne peuvent être ses représentants ; ils ne sont que ses commissaires ».
- Elle est indivisible. Rousseau est hostile à la séparation des pouvoirs, aux corps intermédiaires, aux factions dans l’État. Un corps représente nécessairement des intérêts particuliers ; il ne faut pas compter sur lui pour faire prévaloir l’intérêt général.
- Elle est infaillible (à condition que les intérêts particuliers se trouvent neutralisés). La volonté générale est « toujours droite et tend toujours à l’utilité publique ». « Le souverain par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être ». Formule moins assurée qu’il ne semble, car le problème c’est que le souverain soit.
- Elle est absolue : « Le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur les siens ». Limité toutefois par « Les bornes du pouvoir souverain : si le pouvoir devient arbitraire, c’est que la volonté générale n’est plus souveraineté »4.
Ce faisant, Jean-Jacques Rousseau consacre l’expression de la souveraineté populaire, à travers l’idée d’intérêt général.
Ainsi conclut-il :
« Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté ? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres »5.
Lors de la réunion des États généraux qui vont se déclarer « Assemblée nationale constituante » sous l’impulsion notamment de l’abbé Sieyès, c’est le principe de « souveraineté nationale » (par des représentants autoproclamés de la nation) qui va ainsi prévaloir.
Selon l’abbé défroqué qui va prendre la tête des délégués du Tiers-Etat :
« la Nation existe avant tout, elle est l’origine de tout ; sa volonté est toujours légale ; elle est la loi même. Avant elle et au-dessus d’elle, il n’y a que le droit naturel »6.
Dès lors, la souveraineté s’incarne dans la Nation, à laquelle appartient le roi. Cette approche de la souveraineté met en exergue le principe de souveraineté nationale qui se retrouvera très vite sur les pièces de monnaie qui seront frappées dans la foulée : « le Roi et la Nation » ; l’un et l’autre font alors corps.
Pour Sieyès, la volonté générale est le « résultat des volontés individuelles, comme la nation est l’assemblage des individus ». « Qu’est-ce qu’une nation – poursuit-il – Un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature ».
Ce faisant, il fait de la souveraineté une question institutionnelle. Cela n’est guère surprenant à la lueur des évènements de 1789.
Et sa pensée sera donc inscrite sous l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des 16-24 août 1789.
C’est cette règle organisationnelle, conduite par la représentation nationale, et ses représentants, qui seront consacrés pendant deux siècles.
Le principe de souveraineté juridique
S’agissant plus précisément de la souveraineté juridique – objet de notre propos – en 1859, dans le Répertoire Dalloz il était énoncé :
« Supposons une nation jouissant de toute son autonomie, de toute son indépendance, de sa souveraineté complète. Elle a le devoir de ne pas empiéter sur la souveraineté des autres peuples, et le droit de repousser toute entreprise sur sa propre souveraineté. Chaque nation est tenue de respecter les lois et actes intérieurs des autres, et aucune n’est autorisée à imposer aux autres ses volontés. De là vient que les décisions judiciaires rendues dans un pays ne sont pas de droit exécutoires dans un autre. »
En quelques lignes, tous les principes de souveraineté, d’autonomie et d’indépendance juridiques se trouvent réunis de manière extrêmement limpide et non contestable.
Et cette approche prévaudra tout au long du vingtième siècle et même largement au-delà, dans un monde alors multipolaire même si l’expression peut sembler a priori anachronique.
Le concert des nations né des traités de Vienne (1815)permettait encore et pour plus d’un siècle ce respect
des indépendances juridiques nationales, sans interventionnisme extérieur ni impérialisme juridique.
En ce sens, Metternich s’exprimait :
« Le droit dans la puissance est une chimère et la puissance dans le droit est un abus. La souveraineté
se trouve là où les deux conditions sont réunies. »
C’est pourquoi, les systèmes juridiques romano-germaniques (ou droit continental) n’ont souffert aucune immixtion ni ingérence jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale (1945).
La rupture de 1989 : l’abandon de la souveraineté juridique ?
Ainsi, la souveraineté institutionnelle s’exerce par ses représentants (députés et sénateurs pour le pouvoir législatif), expression de la somme des individus composant la Nation, et sur le territoire national, sans autre forme « d’extraterritorialité » c’est-à-dire sans ingérence ni dépossession.
La règle se retrouve sous l’Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
Ironie de l’histoire peut-être, mais la rupture juridique avec cette idée de souveraineté nationale poindra lors du bicentenaire de la Révolution française, avec l’arrêt dit « Nicolo ».
En effet, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Par conséquent, avant cette décision Nicolo, le Conseil d’État considérait ne pas avoir la possibilité d’écarter une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci : le Conseil d’État faisait prévaloir la loi sur le traité. Il ne s’estimait pas habilité à écarter l’application d’une loi, même contraire à un traité, au nom de plusieurs considérations, du seul ressort du Conseil constitutionnel.
Précisément, c’est de cette juridiction qu’un premier revirement devait poindre à l’occasion de l’examen de la loi du 15 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse considérant qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », au motif que la supériorité établie par l’article 55 n’a qu’un caractère contingent puisqu’elle est subordonnée à une condition d’application réciproque du traité par les parties.
Dès lors, le juge constitutionnel se refusant à contrôler lui-même l’application de l’article 55 de la Constitution, les autres juridictions pouvaient apprécier souverainement.
Dans la foulée, la Cour de cassation faisait donc primer le traité sur la loi nationale dans son arrêt de chambre mixte du 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre.
Avec l’arrêt Nicolo ce fut la reconnaissance et l’introduction sans réserve, par la justice administrative dans le droit français du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Depuis lors, dans la hiérarchie des normes juridiques, la loi française, expression de la souveraineté nationale, a une valeur inférieure aux traités et accords internationaux.
Ce revirement avait déjà été précédé de l’Acte Unique Européen (AUE), en 1986, instituant ou confirmant des institutions supranationales. Puis la souveraineté nationale fut largement effacée, après le référendum du 29 mai 2005 ayant conduit à refus du traité établissant une constitution pour l’Europe, contourné par le vote du Parlement et de ses représentants.
Une contestation de la primauté du droit européen ?
Mais depuis lors, la souveraineté nationale réapparaît, notamment en Allemagne par le truchement d’une décision de Justice7
par laquelle elle a rappelé la primauté du droit constitutionnel sur les traités européens. Ensuite, la Pologne a suivi ce même raisonnement.
Rappelons par ailleurs, malgré les entorses répétées à la souveraineté juridique des pays membres par les institutions et juridictions européennes que l’article 4 § 2 du Traité sur l’Union Européenne affirme : « La sécurité nationale reste de la seule compétence de chaque État membre ».
Par conséquent, la sécurité nationale reste et demeure un privilège (au sens « priva lex ») souverain et régalien de chaque Etat ; sans doute est-ce le dernier apanage national de souveraineté juridique.
- Jean BODIN, Les six livres de la République, 1576
- État fédéral et confédération d’états par Louis Le Fur (1896) p. 443
- ROUSSEAU Jean-Jacques, du Contrat social, 1762
- Cité par TOUCHARD Jean, Histoire des idées politiques, Tome 2, du XVIIIe siècle à nos jours, PUF, 1958, pp. 425-426
- ROUSSEAU, Jean-Jacques, Ibid.
- SIEYES, Qu’est que le Tiers-Etat ? 1789
- Arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe de mai 2020, qui avait contesté la validité d’un rachat de titres de dettes d’État de la Banque centrale européenne (BCE)
