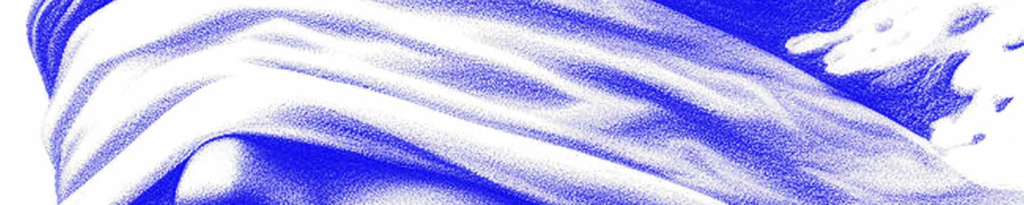
Guillaume BERNARD, Maître de conférences (HDR) de l’ICES
Que la souveraineté soit invoquée dans le domaine politique (souveraineté monétaire1 , européenne2) ou économique (souveraineté industrielle3 , alimentaire4), la notion renvoie essentiellement aujourd’hui à l’idée d’indépendance. Or, concernant aussi bien la personne individuelle que collective, elle est un concept assurément plus complexe5 et, ce, d’autant plus qu’elle a connu, dans les développements classique et moderne de la philosophie politique, des conceptions antinomiques.
Certes, d’intéressants débats portent actuellement sur les mécanismes de la souveraineté : sa répartition au sein de l’État (décentralisation / fédéralisation)6 ou sa régulation entre États (relations internationales / organisations supranationales). Mais ceux-ci restent le plus souvent centrés sur la définition moderne de la souveraineté7 dont les caractéristiques ont été déterminées aux XVIe et XVIIe siècles.
Dès lors, essayer d’avoir une fine compréhension de la souveraineté doit conduire à s’interroger, de manière dialectique, sur sa finalité et donc ses limites (1), sa place dans la hiérarchie des pouvoirs (2), l’articulation des fonctions qu’elle met en œuvre (3) et, enfin, la détermination de l’organe chargé de l’exercer ainsi que des modalités du contrôle de sa légitimité (4).
La finalité et les limites de la souveraineté
Pour la pensée classique, elle est l’un des rôles devant être rempli dans le cadre des relations d’altérité : celui d’arbitre. Dans la vision moderne aujourd’hui dominante, elle est une puissance d’auto-détermination susceptible d’être projetée tant au sein d’un corps social que sur un autre. Alors que la souveraineté est, du point de vue classique, le pouvoir ayant en charge de garantir le bien commun qui lui est extérieur, elle a, dans sa version moderne, la capacité de déterminer ce qu’est l’intérêt général (à l’instar du juste résultant du légal).
Le choix quant à la finalité de la souveraineté a directement des conséquences sur ses limites (lieux d’application, domaines d’intervention). Les bornes de la souveraineté classique sont inscrites dans l’ordre cosmologique des choses (peu importent ici les théories sur son origine) auquel l’action des hommes est subordonnée : chaque catégorie de corps social (famille, entreprise, nation …) a une ontologie et donc une compétence particulière. Dans la vision moderne, la souveraineté n’a pas d’autre limite que la faculté qui, de l’intérieur du corps social (résistance de ses membres) ou de l’extérieur (rapport de force), peut lui être opposée.
C’est ainsi que les relations entre les peuples ont basculé du jus gentium (le règlement du conflit dépasse les seuls intérêts des belligérants car il est un bien qui leur est commun et qui s’impose à toutes les parties) à la volonté du vainqueur, autrement dit la loi du plus fort.
La place de la souveraineté dans la hiérarchie des pouvoirs
Depuis le juriste du second XVIe siècle Jean Bodin, la modernité politique considère la souveraineté comme une puissance indivisible9, le pouvoir le plus élevé ne pouvant être ni subordonné à un supérieur, ni partagé avec un inférieur. Par conséquent, abandonner vers le haut une part de la souveraineté ne peut qu’être une étape provisoire dans la construction d’un échelon supérieur qui, à terme, sera souverain à la place des entités l’ayant constitué (c’est le modèle du fédéralisme par association).
Puisqu’un seul niveau de pouvoir peut être souverain, cela conduit, comme lors de la Révolution française, à la dé-légitimation politique d’institutions comme la famille ou la communauté de métiers, à la privatisation des corps intermédiaires et à l’atomisation individualiste de la société. Le communautarisme contemporain, éminemment moderne, ne doit pas être confondu avec les communautés traditionnelles des sociétés classiques dans la mesure où y sont orchestrés des groupes sociaux délibérément construits non pas sur la base des personnes prises dans leur intégralité mais en se focalisant sur l’une de leurs caractéristiques (sexuelle, culturelle, religieuse)10.
La pensée classique, quant à elle, déclare souverain le pouvoir ayant l’autorité pour réaliser le bien commun dans et pour un corps social particulier. Une hiérarchie de pouvoirs souverains est donc possible puisque nombre de corps sociaux s’imbriquent les uns dans les autres. Comme en témoignait Philippe de Beaumanoir dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la souveraineté du baron dans la baronnie n’empêchait pas que le roi fût souverain dans le royaume11.
La souveraineté classique est indissociable de la subsidiarité12. Il peut exister différents étages souverains puisque chacun d’eux se révèle avoir, en fonction des circonstances, des compétences différentes : ainsi, la famille éduque-t-elle les enfants mais peut être amenée à déléguer une part de leur instruction à l’école. La répartition des pouvoirs entre les différents niveaux souverains est donc nécessairement fluctuant.
Dans ces conditions, le souverainisme13, qui s’exprime surtout depuis la décennie 1990, est ambigu puisqu’il peut être pensé de deux façons fort distinctes : soit comme l’exaltation moderne d’une souveraineté étatique considérée comme indépassable, soit comme la manifestation de la pensée classique dénonçant certains abandons de pouvoir comme contraires, hic et nunc, à une juste subsidiarité.
L’articulation des fonctions souveraines judiciaire et normative
À l’aide de quelles fonctions politiques la souveraineté est-elle exercée ? La modernité fixe la marque de la souveraineté dans la capacité de faire et de casser la règle juridique14, tous les autres pouvoirs (rendre justice, battre monnaie, déclarer la guerre…) étant censés en émaner15. Il y a, là, une inversion de l’articulation des fonctions judiciaire et normative16 telles qu’elle existait dans la société classique pour qui la principale mission de la souveraineté consistait à rendre justice (rétablir l’harmonie de l’ordre des choses qui avait été perturbée par une démesure des hommes), les autres offices découlant d’elle. Ainsi, la règle juridique classique n’était elle pas (pré) établie de manière rationaliste pour être plaquée sur le monde réel, mais issue de l’expérience sociale (coutumes, règlements judiciaires des litiges). La doctrine juridique romaine (Digeste, 50, 17, 1) proclamait que l’« on ne doit pas tirer le droit de la règle, mais la règle du droit »…
Ce retournement (incarné par la célébrissime formule de Montesquieu selon laquelle le juge serait une « bouche qui prononce les paroles de la loi ») a plusieurs causes doctrinales. Mais la principale d’entre-elles s’enracine dans le contractualisme social qui s’épanouit à partir du XVIIe siècle . Dans cette théorie de la sociabilité artificielle, les hommes seraient passés de l’état de nature (où leur conservation n’était pas assurée) à l’état de société à l’aide d’au moins un contrat (d’association). Dans la mesure où il n’existerait pas de loi naturelle (ou du moins de consensus des hommes sur son contenu), il est d’une impérieuse nécessité (sous peine de voir la société nouvelle se déliter) que des règles de vie en commun soient établies (et imposées à tous) : tel est le rôle du pouvoir souverain moderne.
L’organe chargé d’exercer la souveraineté et
le contrôle de sa légitimité
Pour être relativement complète, une synthèse de l’alternative philosophique entre Classiques et Modernes sur la souveraineté nécessite d’évoquer l’organe chargé de l’exercer. Dans une optique organiciste s’inscrivant dans une sociabilité naturelle, la pensée classique désigne naturellement la tête du corps social (chef de famille, chef d’entreprise, chef de l’État…). À l’inverse, la modernité confie le pouvoir souverain au corps social en lui-même. Il est en effet logique que la théorie contractualiste octroie le pouvoir à ceux-là mêmes sans qui la société n’existerait pas. Dans cette solution, reste encore à déterminer si les membres du corps social peuvent et doivent exercer la souveraineté directement (référendum, mandat impératif liant les élus) ou indirectement (système représentatif).
Cela dit, quels que soient les régimes politiques et leurs soubassements idéologiques, les légitimités (du pouvoir) par l’exercice (les résultats concrètement obtenus) et par l’origine (divine ou populaire, traditionnelle ou rationaliste) sont toujours combinées . Mais, tandis que la pensée classique donne la prééminence à la première, la modernité préfère la seconde. Il n’est peut-être pas inutile de relever que la propagande en faveur de la monarchie de droit divin sous l’Ancien régime (pour conjurer le régicide après ceux de 1589 et de 1610) donnait des gages à la modernité. Elle a sans doute favorisé le basculement vers la souveraineté d’origine populaire en focalisant une part du discours officiel sur l’origine (en l’occurrence divine) du pouvoir royal au détriment de sa légitimité par l’exercice.
En tout état de cause, il est naturel que, au-delà de la confiance qu’ils peuvent leur accorder, les gouvernés surveillent les gouvernants puisqu’il en va de leur avenir. Le contrôle porte prioritairement, dans la pensée classique, sur les résultats effectifs de la politique menée alors qu’il concerne en premier lieu, pour la pensée moderne, le respect des procédures établies en matière décisionnelle. Symétriquement, les membres du corps social obéissent aux prescriptions du pouvoir soit parce que celles-ci permettent de réaliser le bien, soit parce qu’elles doivent être respectées eu égard à la position dominante (autorité supérieure, volonté générale) de l’organe qui les a produites.
Ainsi, la supériorité du souverain est-elle bien plus équivoque qu’il n’y paraît, communément, à première vue. L’histoire et la philosophie sont indispensables à l’appréhension de la souveraineté pour celui qui n’entend pas rester prisonnier de la pensée dominante du moment.
- Alexandre DESRAMEAUX, Recherches sur le concept juridique de souveraineté monétaire, Thèse de droit, Jean-Jacques Bienvenu, dir., Paris II, 2006, dactyl.
- François-Vivien GUIOT, dir., La souveraineté européenne, Du discours politique à une réalité juridique ?, Paris, Mare & Martin, 2022.
- Élie COHEN, Souveraineté industrielle, Vers un nouveau modèle productif, Paris, Odile Jacob, 2022.
- Pierre JACQUEMOT, Souveraineté agricole et alimentaire en Afrique, La Reconquête, Paris, L’Harmattan, 2021.
- Guilhem GOLFIN, Souveraineté et désordre politique, Paris, Cerf, 2017.
- Guillaume BERNARD, « Territoire et souveraineté : une révolution permanente ? », in La Révolution permanente, Paul Salün, dir., Paris, Presses de la Délivrance, 2019, p. 263-281.
- Gérard MAIRET, Le principe de souveraineté, Histoire et fondements du pouvoir moderne, Paris, Gallimard, 1996.
- Guillaume BERNARD, « Préface », in Le Bien commun, Questions actuelles et implications politico-juridiques, Miguel Ayuso, dir., trad. de l’esp., Paris, Édition Hora Decima, 2021, p. 5-11.
- Jean BODIN, Les six livres de la République [1576, Lyon, 10e éd., 1593], éd. Christine Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais, Paris, Fayard, 1986, 6 vol., t. II, Liv. II, Chap. 1, p. 11 : « la souveraineté est chose indivisible »
- Guillaume BERNARD, « La dangerosité sociale du communautarisme ? », in Essais de philosophie pénale et de criminologie, IX, Paris, Dalloz, 2010, p. 353-365.
- Philippe DE BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, éd. Amédée Salmon, Paris, 1899-1900, 2 vol., réimpr., Paris, Picard, 1970, 2 vol., t. II, Chap. XXXIV, § 1043, p. 23 : « chacuns barons est souverains en sa baronie », mais « li rois est souverains par dessus tous ».
- Chantal DELSOL, L’État subsidiaire, Ingérence et non-ingérence de l’État, Le principe de subsidiarité aux fondements de l’histoire européenne, Paris, PUF, 1992 ; du même auteur : Le principe de subsidiarité, Paris, PUF, 1993.
- Marc JOLY, Le souverainisme, Pour comprendre l’impasse européenne, préface de Philippe de Saint-Robert, postface de Jean-Pierre Chevènement, Paris, François-Xavier de Guibert, 2001 ; Thomas GUENOLE, Le souverainisme, Paris, PUF, 2022.
- BODIN, op. cit., t. I, Liv. I, Chap. 10, p. 306 : « la premiere marque du prince souverain, c’est la puissance de donner loy à tous en general, et chacun en particulier » ; p. 308 : « la puissance de la loy gist en celuy qui a la souveraineté ».
- Ibid., t. I, Liv. I, Chap. 10, p. 309 : « Sous ceste mesme puissance de donner et casser la loy, sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté : de sorte qu’à parler proprement on peut dire qu’il n’y a que ceste seule marque de souveraineté, attendu que tous les autres droits sont compris en cestui là ».
- Guillaume BERNARD, « De l’art judiciaire à la production législative : l’inversion de la hiérarchie des fonctions souveraines», in Penser la technique juridique, Alexandre Desrameaux, François Colonna d’Istria, dir., Paris, LGDJ, 2018, p. 55-73.
- MONTESQUIEU, De L’esprit des Lois, éd. Jean Brethe de la Gressaye, Paris, Les Belles Lettres, 1950-1961, 4 vol., t. II, Liv. XI, Chap. VI, p. 72.
- Guillaume BERNARD, « Les deux cités, Société et pouvoir dans les pensées classique et moderne », in Tu es Petrus, 2016, XI-XII, p. 53-62.
- Guillaume BERNARD, « Légitimité », in Dictionnaire de la politique et de l’administration, Guillaume Bernard, Jean-Pierre Deschodt, Michel Verpeaux, dir., Paris, PUF, 2011, p. 161-162.
- Guillaume BERNARD, « Splendeur et misères de l’obéissance », in Tu es Petrus, 2020, XXVII, p. 93-101.
