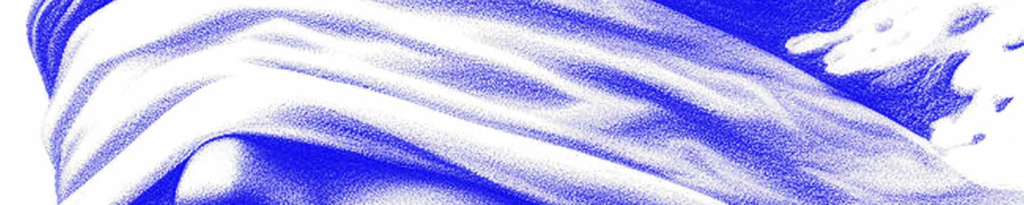
Cyrille DOUNOT, Agrégé des facultés de droit, Professeur d’histoire du droit – Université de Toulouse Capitole
Lorsqu’on évoque la souveraineté, le nom de Jean Bodin revient inlassablement. La définissant comme « puissance absolue et perpétuelle d’une république », il y voyait l’équivalent de la majestas des Romains, et lui attribuait des marques dont la principale est la faculté de « donner et casser la loi ». Cette conception de la souveraineté est à la fois fondatrice d’une certaine modernité politique, mais aussi réductrice, en ce qu’elle semble faire du concept un intemporel ayant existé de tout temps et dans
toutes les sociétés (il ajoutait que la souveraineté était l’équivalent du tomadchavet des Hébreux et de la segnoria des Italiens). Or, la fondation bien réelle du concept de souveraineté s’inscrit dans une histoire particulière, celle de la chrétienté médiévale et de la fin du rêve de l’imperium mundi, qui emprunte certes beaucoup à Rome, mais par l’entremise d’une relecture de ses sources juridiques lors de la redécouverte des compilations de Justinien.
Cette histoire s’écrit en deux temps, d’abord avec l’Église, ensuite avec la France.
Le premier temps est celui de la conceptualisation de l’autonomie des pouvoirs spirituel et temporel. La chose est bien connue, c’est le Christ qui fonde cette distinction toute neuve entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu (S. Matth. 22,21, S. Marc 12,17,
S. Luc 20,25). Les souverains pontifes transposent cette doctrine, dès Gélase Ier en 494, en des termes juridiques qui passent à la postérité : « Il y a deux principes, Empereur Auguste, par qui ce monde est régi au premier chef : l’autorité sacrée des pontifes et la puissance royale » (D. 96, c. 6). En opposant l’auctoritas à la potestas, le pape se sert de la terminologie juridique impériale et s’octroie la meilleure place, celle de la dignité morale surplombant et validant le pouvoir d’exécution. Il n’est pas encore question de souveraineté. Des siècles plus tard, les canonistes insistent sur la divisio regnorum contre le principe impérial, et lors de la Querelle des Investitures (grand conflit opposant le Sacerdoce et l’Empire, entre guelfes partisans du pape et gibelins partisans de l’empereur, 1075-1122), une nouvelle étape est franchie avec la théorie des deux glaives. C’est une interprétation allégorique d’un extrait de l’Évangile
selon saint Luc (22, 38) due au moine Godescalc, établissant contre les prétentions pontificales l’autonomie des deux pouvoirs temporel et spirituel :
« À l’insu de Dieu, [le pape] avait usurpé le regnum et le sacerdotium à son profit. En agissant ainsi, il méprisait les saintes dispositions de Dieu, que Celui-ci voulait consister non pas en un, mais en deux principes : deux, c’est-à-dire le regnum et le sacerdotium, comme le Sauveur l’avait donné à entendre durant sa passion par la suffisance figurée de deux glaives. Lorsqu’on Lui dit : ‘Maître, voilà deux glaives’, il répondit : ‘Cela suffit’, signifiant par cette dualité suffisante que devaient être portés dans l’Église un glaive spirituel et un glaive charnel par lesquels tout ce qui était dommageable serait coupé : le glaive sacerdotal serait utilisé pour encourager l’obéissance au roi au nom de Dieu, alors que le glaive royal serait utilisé pour repousser les ennemis du Christ à l’extérieur et imposer l’obéissance au sacerdotium à l’intérieur ».
Dès lors, les théologiens seront presque tous unanimes à reconnaître que les deux pouvoirs, du fait de leur commune origine divine, sont tous deux parfaits dans leur ordre, et donc souverains (bien que le mot n’existe pas encore). C’est ainsi que saint Thomas d’Aquin, docteur commun de l’Église, affirme :
« La puissance spirituelle et la puissance séculière dérivent l’une et l’autre de la puissance divine ; c’est pourquoi la puissance séculière n’est subordonnée à la puissance spirituelle que dans la mesure où elle lui a été soumise par Dieu, c’est-à dire en ce qui relève du salut des âmes ; dans ce domaine il vaut mieux obéir à la puissance spirituelle qu’à la puissance séculière. Mais en ce qui concerne le bien politique, il vaut mieux obéir à la puissance séculière qu’à la puissance spirituelle, selon ce qui est dit en Mt 22,21 : ‘Rendez à César ce qui est à César’ » (Super sent., II, d. 44, expositio textus, ad. 4).
C’est dans ce contexte doctrinal et politique (celui de la féodalité) que l’Église reconnaît, par la voix du pape Innocent III, que les chefs temporels sont constitués par Dieu pour régir leur communauté politique. Il s’agit de la fameuse réponse donnée au comte de Montpellier en 1202 (décrétale Per venerabilem) dans laquelle il indique que « le roi ne reconnaît aucun supérieur au temporel ». Il s’agit là d’une simple incise visant à éconduire la demande formée par le comte de légitimation de ses bâtards, au motif que cette question purement temporelle relève du pouvoir temporel du roi, seigneur légitime du comte. La France entre alors dans le jeu pour définir et déterminer le concept de souveraineté, tant par la récupération habile qu’en feront ses juristes, que par l’action politique de ses rois. Ceux-ci étaient déjà parvenus à dominer la féodalité pour devenir suzerain suprême du royaume : tous les seigneurs quels qu’ils fussent (du simple chatelain aux comtes et aux ducs) étaient soumis au roi par un lien vassalique. Le roi est suzerain fieffeux, à la tête de tous les fiefs du royaume, et ne devant l’hommage à personne. Il va de plus devenir l’égal de l’empereur dans les limites de son royaume.
Au XIIIe siècle, les juristes français (mais aussi italiens, anglais ou allemands), vont reprendre le vocabulaire romain du pouvoir politique (auctoritas, potestas, majestas, jurisdictio) pour l’appliquer à la personne du roi. Le juriste Jean de Blanot va indiquer que « le roi de France est empereur en son royaume » (1250), et cette formule fait florès, traduite en français en 1303 par Guillaume de Plaisians, un des principaux légistes de Philippe le Bel. Elle signifie que le roi de France dispose, dans son royaume, des mêmes prérogatives que l’empereur romain en son Empire. Le pouvoir royal est de la même essence juridique que le pouvoir impérial. Vers 1272, un recueil coutumier précise l’argumentation : « le roi n’a point de souverain en choses temporelles, il ne tient de nul que de Dieu et de lui » (Etablissements de Saint Louis). C’est la première étape d’affirmation théorique de la souveraineté. Le mot apparaît à la fin du XIIIe siècle (1282), dans une plainte transmise au parlement de Paris, contre l’évêque de Laon qui s’était permis de juger en appel au mépris de « la justice et la souveraineté » du roi. Le mot souverain apparaît même avant le mot de suzerain. Dès la fin du Moyen-Âge, grâce à la renaissance du droit romain, les juristes emploient des termes qui expriment ce que nous entendons par souveraineté : pouvoir suprême, complet, inaliénable, et capacité de faire des lois. Comme le dit le juriste Beaumanoir à la fin du XIIIe siècle, « chaque baron est souverain en sa baronnie. Cependant, le roi est souverain par-dessus tout et a, de plein droit, la garde générale de tout le royaume, par quoi il peut faire tous les établissements qu’il lui plait pour le commun profit ».
La seconde étape consiste en l’application pratique de cette souveraineté. Au plan interne, à savoir la suprématie du roi sur les seigneurs et les autres corps constitués (villes, abbayes et monastères, métiers, etc), cela se produit progressivement tout au long des XIIIe, XIVe et XVe siècle. Cela culmine durant la guerre de Cent Ans avec la faculté royale de légiférer, d’imposer (et l’impôt servira à financer l’armée royale permanente, sous Charles VII), de juger en dernier ressort et de battre monnaie. On retrouve là les pouvoir régaliens qui fondent la souveraineté : décider de la paix et de la guerre, adopter la loi ou le traité international, assurer la justice et l’ordre public, contrôler la politique monétaire et fiscale, en bref, décider pour soi, chez soi.
Au plan international, l’affirmation de la souveraineté du roi de France, et de la France par ricochet (car elle est représentée par son roi, son souverain), s’est exercée prioritairement contre deux institutions présentant des tendances universalistes : l’Église catholique et l’Empire romain germanique. Les conflits houleux de Philippe le Bel et Boniface VIII ont permis d’abord d’asseoir la place de la France dans la chrétienté contre des velléités de théocratie pontificale et de féodalité ecclésiastique. Le pape réclamait un droit d’intervention directe dans les affaires politiques de la France (au motif du péché du roi de France), le roi a répondu vivement (même trop, par l’attentat d’Anagni de 1303) que « nous ne sommes sujet à personne au temporel », fut-ce au pape.
Contre l’Empire, c’est très tôt, dès Bouvines (1214), que la France impose sa place dans le concert des nations. Saint Louis, protestant contre la capture en mer de prélats français par l’empereur, lui écrit que « le royaume de France n’est pas encore si affaibli qu’on puisse le mener à coups d’éperons » (1241). Son petit-fils Philippe le Bel rappelle à l’empereur Henri VII qu’il aurait dû reconnaître le royaume de France « comme exempt de cette sujétion générale » qu’il revendiquait, « car il est notoire et généralement connu de tous et partout que depuis l’époque du Christ le royaume de France n’a jamais eu d’autre roi que le sien, placé directement sous Jésus-Christ […] et n’a jamais eu ni reconnu aucun supérieur temporel ». Ainsi, dès le XIIIe siècle, sont présents et explicités tous les instruments doctrinaux d’affirmation de la souveraineté, comme nouveau concept du droit public consacrant l’indépendance du royaume. Il faudra les aléas de l’histoire, comme la guerre de Cent Ans ou plus tard les guerres de Religion, pour que la royauté matérialise toute l’étendue de sa souveraineté, et que les juristes en viennent à la cerner comme « pas plus divisible que le point en la géométrie » (Cardin Le Bret). C’est aussi graduellement, avec le secours de la philosophie d’Aristote, que les penseurs vont considérer la souveraineté non plus seulement comme l’attribut de la personne du roi, mais comme celui d’un corps impersonnel, l’État. Loyseau, au XVIIe siècle, parachève cette évolution en exposant que la souveraineté est « la propre seigneurie de l’État », ou encore « le comble et période de puissance où il faut que l’État s’arrête ».
